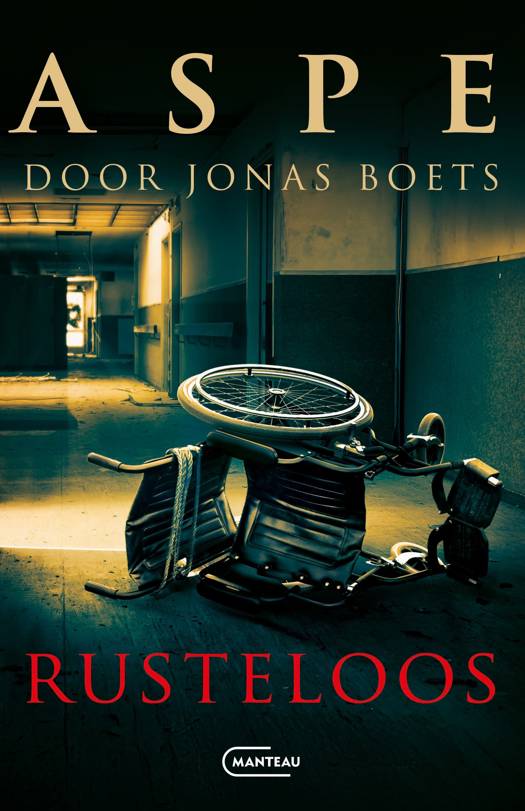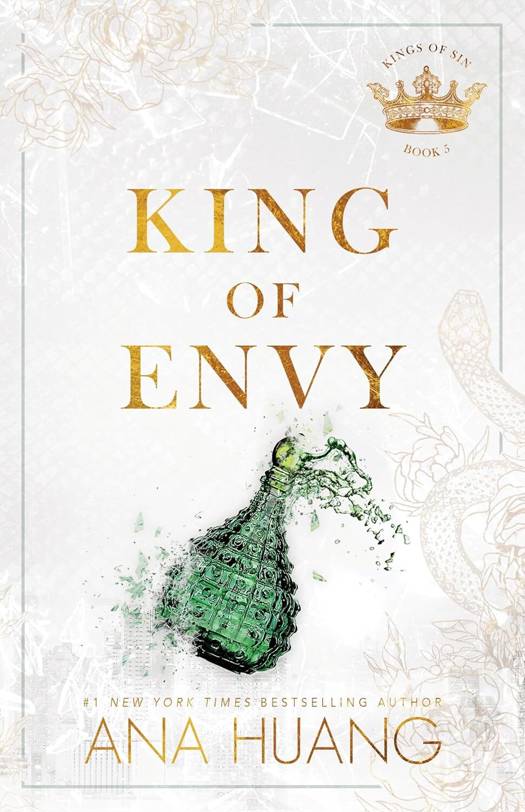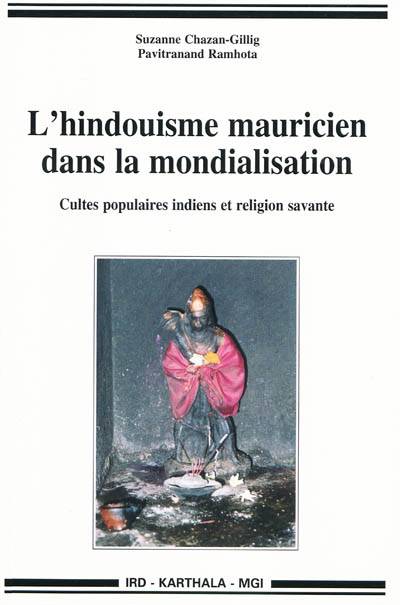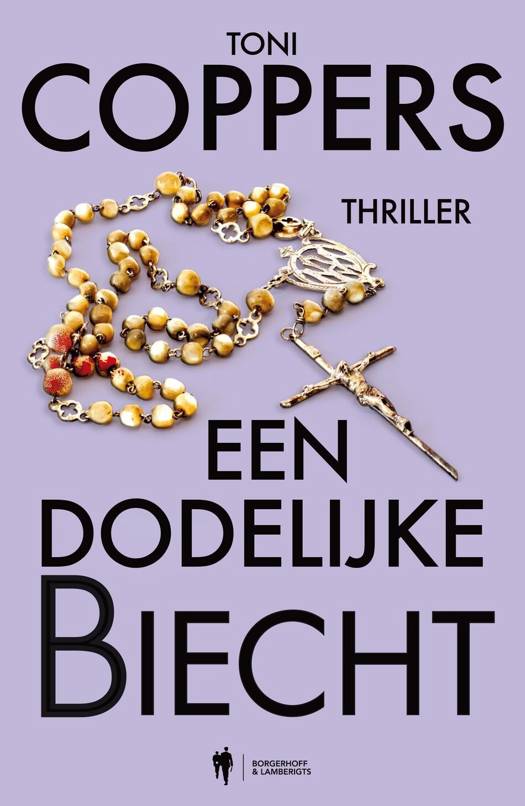
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
L'hindouisme mauricien dans la mondialisation
cultes populaires indiens et religion savante
Suzanne Chazan-Gillig, Pavitranand RamhotaOmschrijving
La société mauricienne contemporaine constitue un terrain particulièrement
riche pour l'étude des interactions du religieux avec l'économique
et le politique. Cela est dû non seulement à la multiplicité de ses
formes religieuses et culturelles - l'hindouisme étant pratiqué par plus
de la moitié de la population -, mais aussi à ses rapports étroits avec
l'économique et l'État, qui fut le grand ordonnateur des catégories de
populations après le Traité de Paris de 1814 conférant la souveraineté
du territoire à l'Angleterre.
Le nouveau modèle colonial inspiré par l'Angleterre, qui a émergé
en 1814, s'est articulé autour de la double valorisation de la religion
et des origines des migrations. C'est ainsi que le culte de la déesse
Kali, dont les autels se sont multipliés dans l'île, s'est modelé autour
de la relation capital/travail instituée sous la colonisation. Actuellement,
l'apparition de divinités nouvelles dans les temples urbains traduit un
processus inéluctable de transformation des cultes populaires en religion
savante. Un changement qui fait suite à la restructuration de l'économie
sucrière et de l'industrie textile avec le développement des Techniques
d'information et de communication (TIC).
Dans cet ouvrage, les auteurs sont partis de l'hypothèse, confirmée
par les enquêtes, que tout changement religieux est un symbole
des transformations structurelles, en réponse aux conséquences de la
mondialisation des marchés. Ils ont établi une corrélation des transformations
symboliques avec les innovations rituelles qui se manifestent
jusque dans les stratégies électorales. Plus globalement, ils ont mis en
lumière, à travers la multiplication des associations culturelles hindoues,
le rapport de l'hindouisme avec les diverses formes du capitalisme mondial,
un point de vue tout à fait original, jamais encore étudié à ce jour.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 522
- Taal:
- Frans
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9782811101947
- Verschijningsdatum:
- 27/07/2009
- Uitvoering:
- Paperback
- Afmetingen:
- 160 mm x 240 mm
- Gewicht:
- 740 g
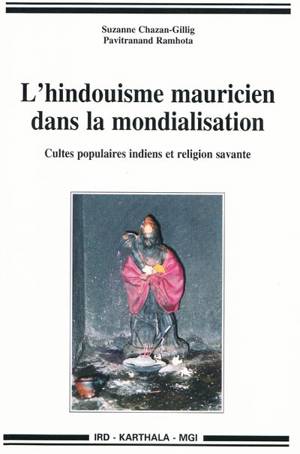
Alleen bij Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.