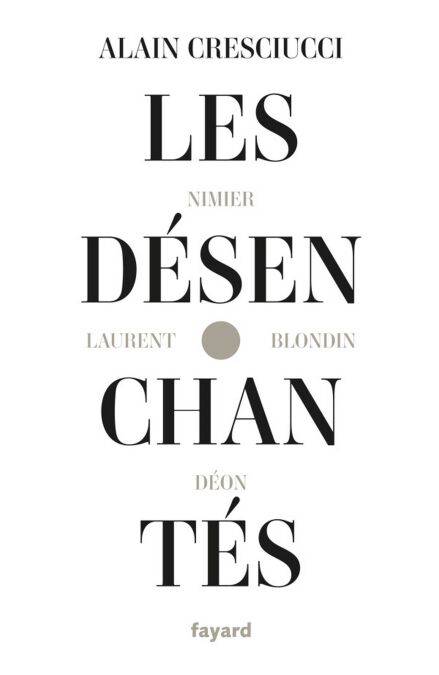- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
€ 14,99
+ 14 punten
Uitvoering
Omschrijving
Fin 1952, un jeune critique des Temps modernes, Bernard Frank, qualifie trois jeunes romanciers − Nimier, Laurent et Blondin − de "Hussards". Ils sont accusés d’être les porte-parole des écrivains bannis par le CNE à la Libération et de servir les intérêts de la vieille littérature bourgeoise défendue par les "Grognards". Contre la caporalisation de la littérature et la théorie de l’engagement, contre le roman réduit au document, contre Sartre et l’existentialisme, ces jeunes écrivains − tous de sensibilité droitière, parfois anciens de la jeunesse d’Action française − prônent un retour au romanesque qu’ils souhaitent dépris de tout propos militant et de toute prétention didactique. Proches de la revue et des éditions de La Table Ronde, ils participent au renouveau de la presse culturelle (Opera, Carrefour, La Parisienne, Arts) et inventent un intellectuel indifférent aux hiérarchies, s’occupant aussi bien de littérature que de cinéma, d’actualité que de sport. Au milieu des années 50 on leur adjoint Michel Déon et, à la manière des mousquetaires de Dumas, les trois Hussards deviennent quatre. Leur désinvolture et leur insolence les font incarner, pour la presse de gauche, la nouvelle droite littéraire. En fait, ils expriment un mal de vivre élégant, celui d’une génération à qui la guerre a volé sa jeunesse, et qui peut prendre aussi bien les allures d’une dolce vita que du désenchantement le plus profond. A la fin des années 50, ces jeunes héros accusent la fatigue d’une existence qui n’était pas de tout repos. Et la mort de Nimier, en septembre 1962, marque la fin symbolique de l’aventure.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 312
- Taal:
- Frans
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9782213664637
- Verschijningsdatum:
- 8/03/2011
- Uitvoering:
- E-book
- Beveiligd met:
- Adobe DRM
- Formaat:
- ePub
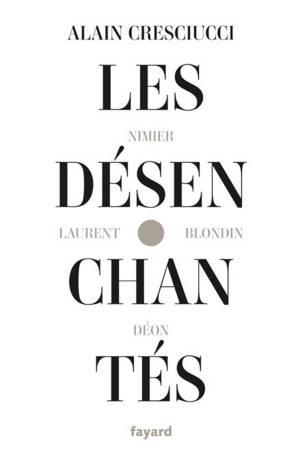
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 14 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.