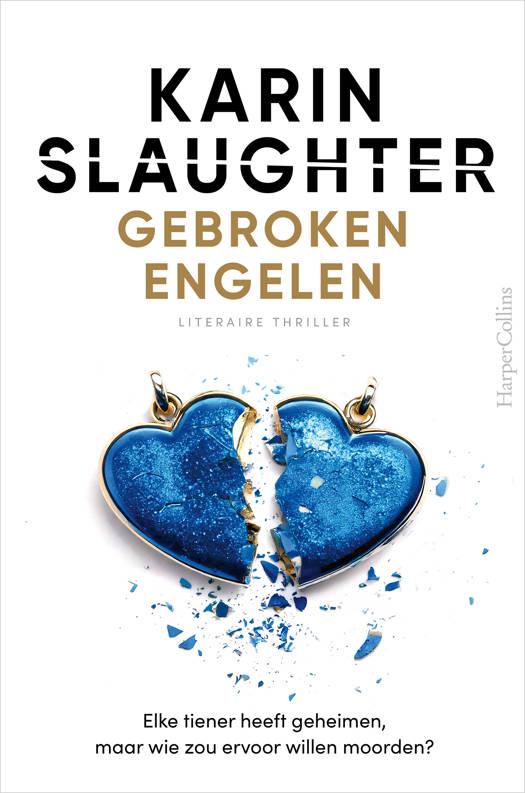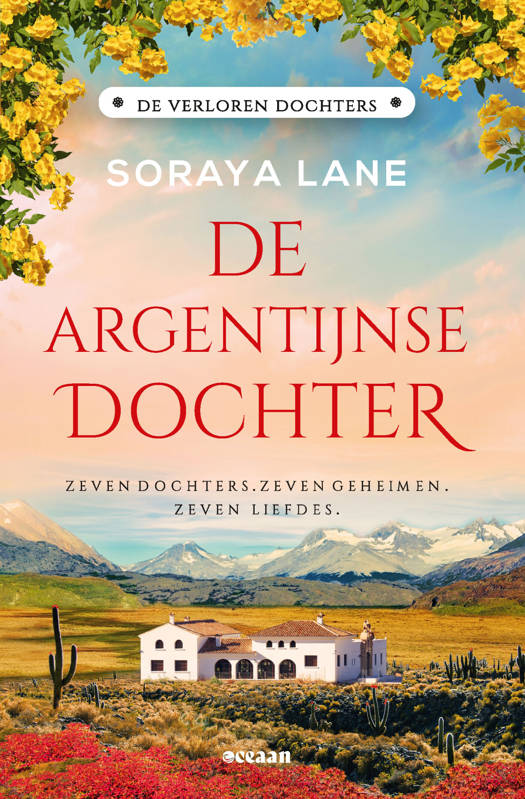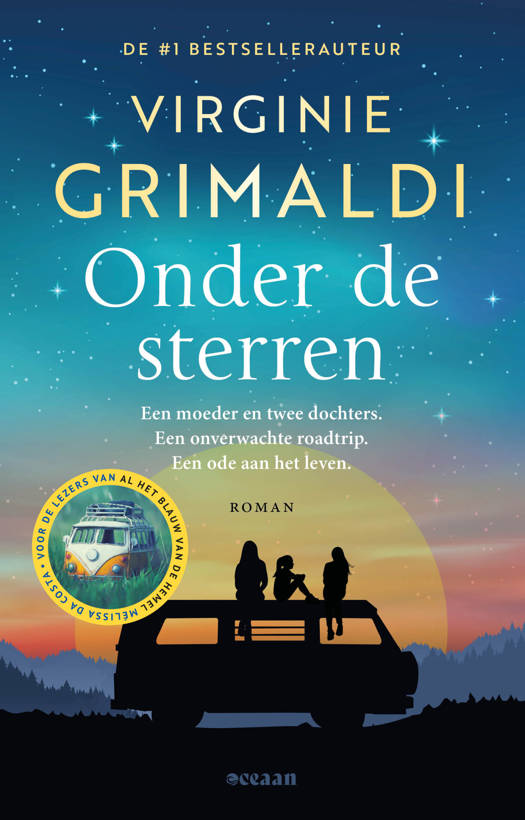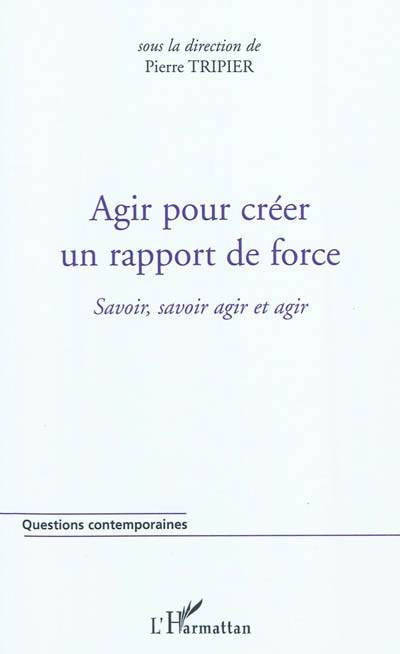- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Omschrijving
«En relations internationales, les grands font ce qu'ils veulent
et les petits ce qu'ils peuvent.»
Cette phrase, du théoricien réaliste des relations internationales
Hans Morgenthau, a quelque chose d'anthropologique et de simple,
une façon première d'envisager le rapport de force.
Mais l'histoire du monde montre que la force ne peut pas
seulement être pensée en termes physiques, comme la capacité à en
avoir plus que l'adversaire et, ainsi, soit le détruire, soit le dominer.
En effet, dans les relations entre humains, si le rapport du fort au
faible apparaît, en cas de conflit, une péripétie dont la fin est écrite
à l'avance, dans un second temps, la capacité d'organisation, de
persuasion et de se faire des alliés peut renverser cette relation
asymétrique.
Par ailleurs, une vue contemporaine affirme que : «Dans le
domaine de la politique internationale (...) les préférences des
acteurs sont souvent inconnues, chaque participant dispose de
nombreuses stratégies possibles, et les coûts et bénéfices des
différents scénarios sont incertains». En somme, les entités
collectives, comme les humains, ont à leur disposition plusieurs
identités, dont ils changent selon l'interlocuteur ou la circonstance,
ce qui peut rendre imprévisible l'issue d'un rapport de force.
Ce livre analyse plusieurs types d'ambivalence des rapports de
force, d'abord dans le domaine militaire, puisqu'il part du
présupposé que l'art de la guerre peut permettre de comprendre les
agissements du monde civil, mais aussi dans les relations entre
syndicats, pouvoirs publics et patronat, dans les relations entre
professeur et élève ; ou, encore, dans le marxisme, pour
comprendre la force des explications de la dynamique sociale en
termes de base matérielle ou d'entités super-structurelles.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 125
- Taal:
- Frans
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9782296561786
- Verschijningsdatum:
- 22/06/2011
- Uitvoering:
- Paperback
- Afmetingen:
- 140 mm x 220 mm
- Gewicht:
- 160 g
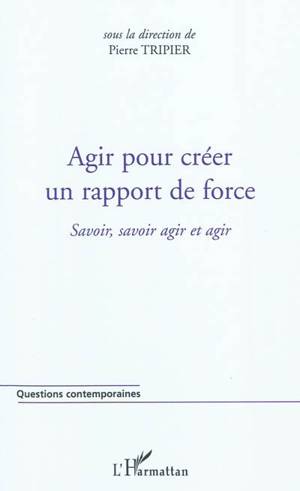
Alleen bij Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.