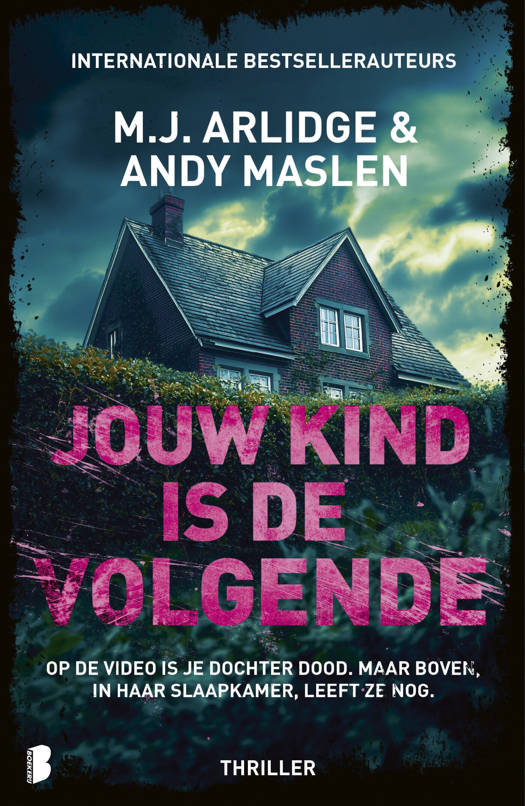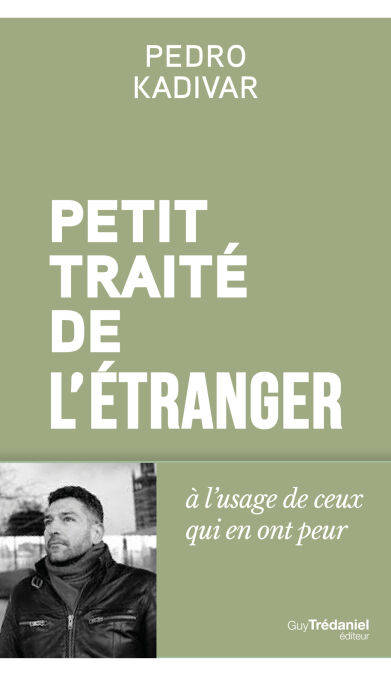- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Petit Traité de l'étranger à l'usage de ceux qui en ont peur E-BOOK
Pedro Kadivar
€ 6,99
+ 6 punten
Uitvoering
Omschrijving
Nouvel opus dans la collection des petits traités philopsophiques. Pedro Kadiva lie vécus personnels et réflexions qui permettront d'élucider les tenants et aboutissants du rapport à l'étranger.
Qui est
l'étranger ? Le terme n'est pas neutre. Sa signification est plurielle et complexe. Sa résonance est ambivalente et chargée d'histoire, de sens et d'exégèses qui l'ont forgé dans l'imagination européenne. Et ce jusqu'à son usage actuel et sa récurrence polémique dans le discours politique portant sur l'immigration.
Le livre se propose de repérer, déceler, déplier les résonances multiples du mot étranger, les préjugés qu'elles véhiculent, en cherchant leurs provenances, en se penchant sur son étymologie et en approfondissant les affects qu'il suscite.
Partant de sa (double) expérience d'étranger et de migrant (de l'Iran en France puis en Allemagne), et y revenant régulièrement le long du livre, l'auteur lie vécus personnels et réflexions qui permettront d'élucider les tenants et aboutissants du rapport à l'étranger. Pour ce faire, par delà son aspect autobiographique, le livre fait appel parallèlement à des concepts philosophiques et à des œuvres littéraires, cherchant aussi les antécédents historiques d'une culture de l'altérité.
Dans une première partie on se penche d'abord sur les définitions du terme, sur ses usages et leurs contradictions, en tension avec des expériences personnelles.
Le chez-soi étant une notion clef pour la définition de l'étranger, celui-ci ayant son chez-soi ailleurs, la deuxième partie s'intéresse de près au sens de ce que serait le chez-soi et ses frontières, à son ouverture possible et vitale à l'ailleurs.
La troisième partie approche le concept qui fonde le rapport à l'étranger, à savoir celui de l'altérité. L'autre, humain comme moi, est à la fois mon semblable et mon dissemblable, il ne m'est jamais identique, mais quand est-il considéré comme étranger ?
Une autre question, celle de l'identité, l'objet de la quatrième partie, est une récurrence quand il s'agit de l'étranger et sa définition. Souvent simplifié, l'écart qui sépare de l'étranger est défini comme un fossé identitaire. Or, les identités humaine et individuelle, intimement liées, ne sont pas des termes fixes et distinctes qui viendraient justifier l'image du fossé qui sépare de l'étranger.
Qui est
l'étranger ? Le terme n'est pas neutre. Sa signification est plurielle et complexe. Sa résonance est ambivalente et chargée d'histoire, de sens et d'exégèses qui l'ont forgé dans l'imagination européenne. Et ce jusqu'à son usage actuel et sa récurrence polémique dans le discours politique portant sur l'immigration.
Le livre se propose de repérer, déceler, déplier les résonances multiples du mot étranger, les préjugés qu'elles véhiculent, en cherchant leurs provenances, en se penchant sur son étymologie et en approfondissant les affects qu'il suscite.
Partant de sa (double) expérience d'étranger et de migrant (de l'Iran en France puis en Allemagne), et y revenant régulièrement le long du livre, l'auteur lie vécus personnels et réflexions qui permettront d'élucider les tenants et aboutissants du rapport à l'étranger. Pour ce faire, par delà son aspect autobiographique, le livre fait appel parallèlement à des concepts philosophiques et à des œuvres littéraires, cherchant aussi les antécédents historiques d'une culture de l'altérité.
Dans une première partie on se penche d'abord sur les définitions du terme, sur ses usages et leurs contradictions, en tension avec des expériences personnelles.
Le chez-soi étant une notion clef pour la définition de l'étranger, celui-ci ayant son chez-soi ailleurs, la deuxième partie s'intéresse de près au sens de ce que serait le chez-soi et ses frontières, à son ouverture possible et vitale à l'ailleurs.
La troisième partie approche le concept qui fonde le rapport à l'étranger, à savoir celui de l'altérité. L'autre, humain comme moi, est à la fois mon semblable et mon dissemblable, il ne m'est jamais identique, mais quand est-il considéré comme étranger ?
Une autre question, celle de l'identité, l'objet de la quatrième partie, est une récurrence quand il s'agit de l'étranger et sa définition. Souvent simplifié, l'écart qui sépare de l'étranger est défini comme un fossé identitaire. Or, les identités humaine et individuelle, intimement liées, ne sont pas des termes fixes et distinctes qui viendraient justifier l'image du fossé qui sépare de l'étranger.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Taal:
- Frans
- Reeks:
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9782813236531
- Verschijningsdatum:
- 4/02/2026
- Uitvoering:
- E-book
- Beveiligd met:
- Digital watermarking
- Formaat:
- ePub

Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 6 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.