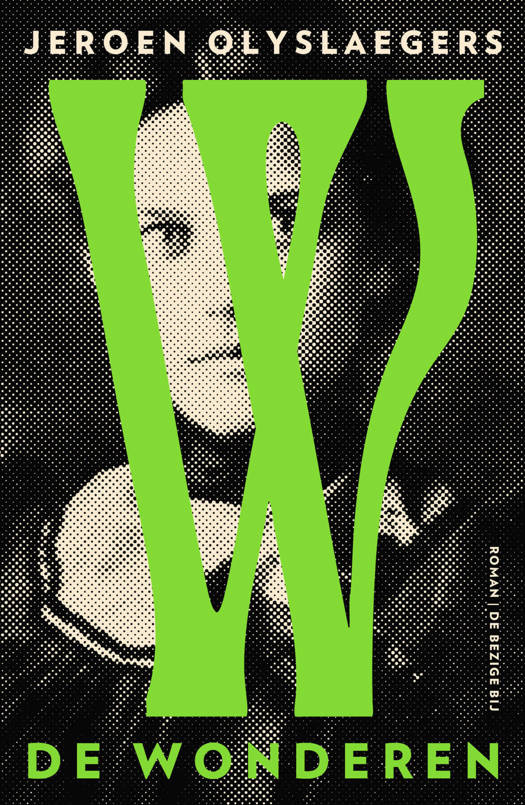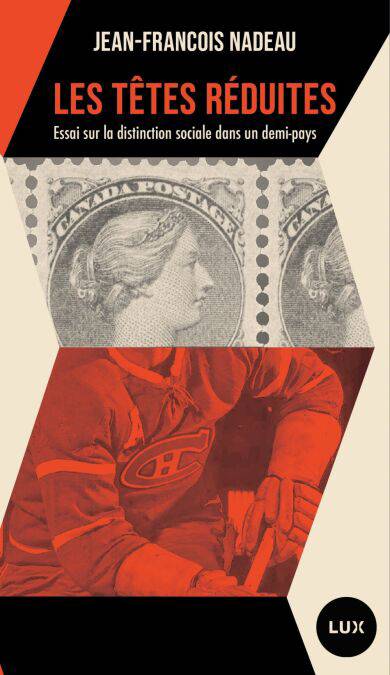- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Les têtes réduites E-BOOK
Essai sur la distinction sociale dans un demi-pays
Jean-François Nadeau
E-book | Frans
€ 11,99
+ 11 punten
Uitvoering
Omschrijving
« En 1955, les émeutiers jurent et pestent en des mots fort peu châtiés contre la suspension de Maurice Richard tandis qu’à la télé un René Lecavalier continue de parler une langue épurée qui n’en paraît que plus déconnectée de ce qui se joue. Le même homme pourra déclarer en ondes, sans broncher, tout à fait imperturbable : “C’est la première fois, incidemment, que nos appareils de télévision ont le plaisir de vous présenter une bagarre”. »
Par l’entremise d’enquêtes journalistiques, de recherches historiques et de souvenirs personnels, Jean-François Nadeau s’interroge sur l’étrange relation des élites québécoises à la culture, à l’éducation et à la langue. Pendant plus d’un siècle, s’étonne l’historien, la prière obligée est restée enfoncée dans la gorge de toute une nation tandis que montait à la bouche de chacun un lot de jurons. Les notables élevaient le travail de la terre, la pauvreté et l’ignorance au rang d’idéal national, tout en défendant une langue qui n’était en usage que dans les beaux salons des villes et des villas. Cet héritage paradoxal pèse encore lourd sur les temps présents.
Des origines d’Anne Hébert et de Saint-Denys Garneau aux casse-croutes que l’on trouve encore le long des routes, de la mémoire du Patriote Chénier aux collectionneurs de timbres, des déclarations d’un ministre du régime Duplessis et du Frère Untel aux lumineux éclats de périodiques irrévérencieux, cet essai saisit sur le vif la question de la distinction sociale au Québec. La culture de ce demi-pays a-t-elle pour destination de construire encore et toujours des têtes réduites ?
Par l’entremise d’enquêtes journalistiques, de recherches historiques et de souvenirs personnels, Jean-François Nadeau s’interroge sur l’étrange relation des élites québécoises à la culture, à l’éducation et à la langue. Pendant plus d’un siècle, s’étonne l’historien, la prière obligée est restée enfoncée dans la gorge de toute une nation tandis que montait à la bouche de chacun un lot de jurons. Les notables élevaient le travail de la terre, la pauvreté et l’ignorance au rang d’idéal national, tout en défendant une langue qui n’était en usage que dans les beaux salons des villes et des villas. Cet héritage paradoxal pèse encore lourd sur les temps présents.
Des origines d’Anne Hébert et de Saint-Denys Garneau aux casse-croutes que l’on trouve encore le long des routes, de la mémoire du Patriote Chénier aux collectionneurs de timbres, des déclarations d’un ministre du régime Duplessis et du Frère Untel aux lumineux éclats de périodiques irrévérencieux, cet essai saisit sur le vif la question de la distinction sociale au Québec. La culture de ce demi-pays a-t-elle pour destination de construire encore et toujours des têtes réduites ?
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 246
- Taal:
- Frans
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9782898331794
- Verschijningsdatum:
- 14/11/2024
- Uitvoering:
- E-book
- Beveiligd met:
- Digital watermarking
- Formaat:
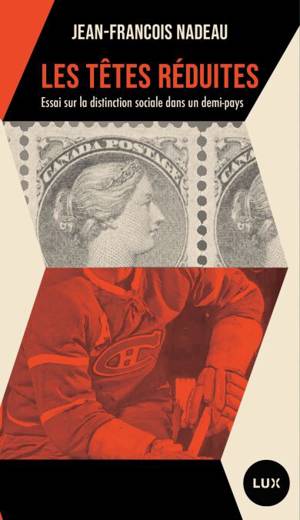
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 11 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.