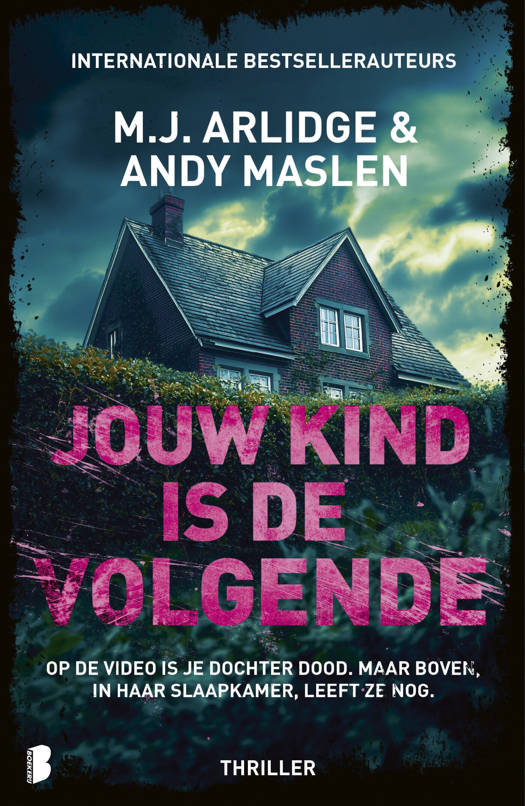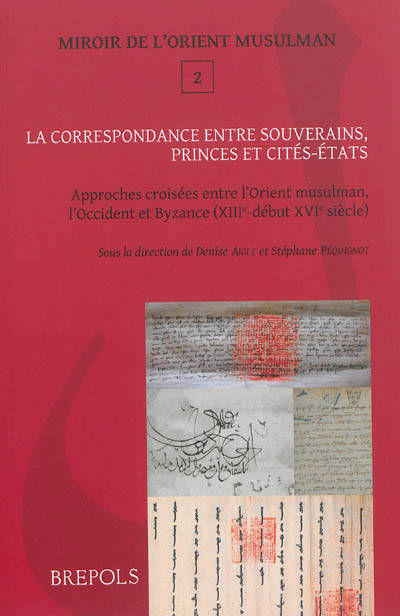- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
La correspondance entre souverains, princes et cités-Etats
approches croisées entre l'Orient musulman, l'Occident latin et Byzance (XIIIe-début XVIe siècle)
Denise AigleOmschrijving
La création au XIIIe siècle de l'Empire mongol suscite de fréquents échanges
diplomatiques entre puissances orientales, mais aussi entre l'Orient, Byzance
et l'Occident. À cette même période, les liens et les tensions qui unissent ou divisent
empereurs, rois et princes chrétiens, se manifestent souvent au cours de rencontres
personnelles ou par l'envoi de messagers et d'ambassades. Les correspondances
des souverains jouent dans ces relations multiformes un rôle essentiel. Elles sont
conservées en nombre croissant pour plusieurs territoires occidentaux sous
domination chrétienne, alors que les lettres originales des souverains musulmans
orientaux demeurent fort rares avant la consolidation de la chancellerie ottomane.
Tout en précisant les raisons de ce profond déséquilibre archivistique, les études
réunies dans La correspondance entre souverains permettent une première approche
comparative des manières de rédiger, de transmettre, de conserver et, le cas échéant,
de réutiliser ces lettres. Du Bosphore à Florence, du Yémen à Rome, de l'Égypte
mamelouke à la cour des Mongols d'Iran, les lettres des souverains véhiculent
des idéologies et, parfois, des prétentions dominatrices contradictoires, elles portent
un discours représentatif du pouvoir dont elles émanent. Pièces centrales des
échanges diplomatiques, les lettres sont imprégnées de modèles de chancellerie,
puis soumises à des processus de transmission qui peuvent s'avérer extrêmement
complexes. Certains originaux sont traduits, quelquefois à plusieurs reprises, par
des intermédiaires aux compétences linguistiques inégales. Grâce à des analyses
croisées menées jusqu'au début du XVIe siècle, l'on voit ainsi apparaître les effets
de l'intensification des échanges diplomatiques sur l'art et les pratiques épistolaires
souveraines.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 238
- Taal:
- Frans
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9782503531472
- Verschijningsdatum:
- 18/06/2013
- Uitvoering:
- Paperback
- Formaat:
- Trade paperback (VS)
- Afmetingen:
- 160 mm x 240 mm
- Gewicht:
- 430 g

Alleen bij Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.